Les chroniques de Jean-Noël BEVERINI
PETITES CHRONIQUES DE LA GRANDE PESTE DE MARSEILLE

« L’année 1720 fut bien plus mémorable par les ravages affreux que la peste fit dans cette Province, et notamment à Marseille ».
Ainsi commence la relation de la peste de 1720-1721 que dresse l’abbé Papon, de l’Académie de Marseille, dans son ouvrage de 1786 :
« Histoire générale de la Provence »
(Paris, imprimerie de PH.- D. Pierres, premier imprimeur Ordinaire du Roi et des États de Provence).
L’ouvrage qui comporte quatre tomes est remarquable dans son habit, sa présentation et son contenu. Ouvrons ensemble le tome quatrième aux pages 634 et suivantes pour cueillir dans la relation de l’Abbé-Académicien ces petites chroniques de la Grande Peste que je vous propose. Il ne s’agit pas de présenter ici l’Histoire bien connue de cette horreur qui ravagea la ville et la Provence mais de partager des histoires vécues par nos anciens marseillais et provençaux.
Savez-vous, par exemple, que le Grand Saint-Antoine, le vaisseau porteur de la peste, ne fut pas le seul à accoster à Marseille en ce funeste mois de mai 1720. Si le Grand Saint-Antoine toucha notre ville le 25 mai, six jours plus tard, soit le 31 mai, trois autres navires suspects venant des mêmes ports furent reçus dans nos eaux.
Pourtant leurs patentes (documents de navigation) étaient brutes, c’est à dire qu’ils étaient « soupçonnés » de peste. Le 12 juin suivant un quatrième navire entrait à Marseille avec également une patente brute. Cela fait tout de même beaucoup !
Le Grand Saint-Antoine, contrairement aux règlements en vigueur, fut autorisé à décharger sa cargaison pesteuse aux « Infirmeries », lieu de quarantaine, alors qu’il aurait dû être envoyé immédiatement sur l’ile de Jarre. Un premier turc passager était, en effet, mort en mer. On avait ordonné à deux matelots de jeter son corps par dessus bord. Les cordes qui avaient servi à traîner le cadavre furent également jetées à l’eau. Les deux matelots ne tardèrent pas à mourir. Deux autres les suivirent. Ainsi que le chirurgien du bord ! Cela faisait déjà six décès suspects.
Vous avez dit suspect ? Le nombre de morts fut bientôt porté à neuf. Mais le Grand Saint-Antoine accosta et débarqua sa marchandise aux Infirmeries. Les quatre autres navires dont parle notre Abbé-Académicien bénéficièrent de la même indulgence.
Les magistrats de Marseille avec à leur tête le sieur Estelle, premier échevin, attribuaient ces morts « à une toute autre cause qu’à la contagion ».
Pourtant les morts commençaient à se multiplier … comme des petits pains ! Mais rien n’est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir ! Des morts rue de l’Escale ! Quand la mort vient de bateaux, quel baptême ! Des morts Place des Dominicains. Des morts rue de l’Oratoire. Des morts, de plus en plus de morts, des morts partout … À ne plus savoir où mettre les cadavres.
Mais la cause officielle tenait selon les premières déclarations officielles « au dérangement de la saison » ou d’ « une mauvaise nourriture ».
Notre cher Abbé-Académicien de Marseille est sans excuse pour les échevins et pour le premier d’entre eux, Estelle :
« Si à la première nouvelle qu’ils eurent que la contagion étoit à Marseille, ils avoient envoyé des médecins sur les lieux, si par des ordres sévères ils auroient défendu toutes communications avec les rues et les maisons suspectes, ils auroient conservé à l’État une infinité de citoyens utiles ».
Et notre académicien parle de « négligence, d’insouciance » des magistrats, « d’aveuglement inconcevable ».
La peste se répandit en ville et hors les murs, le commerce de Marseille conservant toute sa liberté. Et l’Abbé d’ajouter :
« Le chirurgien, d’accord avec les propriétaires du navire, ne voulût point dire ce qu’il pensoit pour ne pas leur faire perdre la cargaison qui était d’un grand prix, il déclara qu’il ne voyait dans ces accidens que les effets d’une maladie ordinaire ».
Au nombre des propriétaires figurait le sieur Estelle, premier magistrat de la ville. Une rue honore son nom. La question se pose sérieusement de savoir s’il convient aujourd’hui, en ces deux années de commémoration de cette tragédie qui envoya des dizaines de milliers de marseillais et de provençaux dans la tombe, de conserver au cœur de notre ville une rue au nom d’Estelle.
(À suivre)
Marseille, le 10 septembre 2021
Jean-Noël Beverini, membre de l'ANACLE
Suite
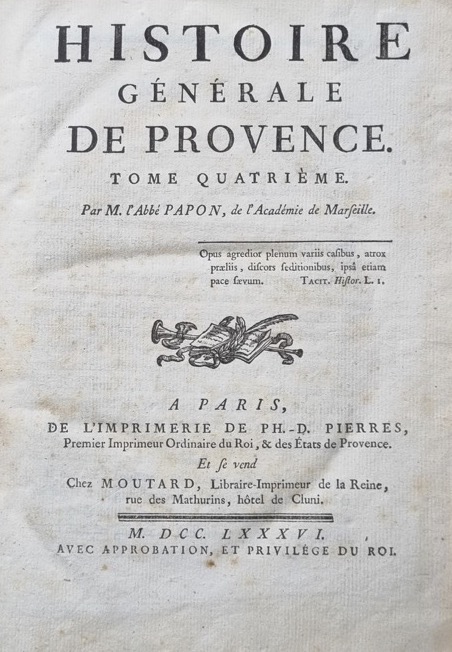
PETITES CHRONIQUES DE LA GRANDE PESTE DE MARSEILLE (2)
Jean-Noël Beverini
UNE GESTION CATASTROPHIQUE DE L’ÉPIDÉMIE
SAUF PAR …
Le 2 juillet 1720, enfin, soit 37 jours après l’arrivée du Grand Saint-Antoine, le Parlement de Provence édictait un Arrêt interdisant toute communication entre les habitants de la Province et les marseillais.
Plus de communication avec l’extérieur, cela signifiait plus d’arrivage de vivres pour Marseille. Au fléau de la peste s’ajoutait celui de la faim. Nos marseillais allaient vivre dans leur chair la Fable de monsieur Jean de La Fontaine écrite 52 ans auparavant ; vous avez deviné : La cigale et la fourmi. Marseille se trouva fort dépourvue quand la peste fut venue ! Et personne auprès de qui aller crier famine. Ni en Europe, ni en Chine ! (Pourquoi donc parler ici de la Chine ?)
Impossible de trouver le moindre grain. Ne nous masquons pas la vérité. Bien avant l’heure le principe du stock zéro était déjà en place. La révolte grondait. Quand le peuple gronde, la fronde n’est pas loin. Le Bret, intendant de Provence, réunit le marquis de Vauvenargues, premier procureur, et notre premier échevin, ce bienaimé Estelle, assisté du Secrétaire de la ville. Nous avons donc, vous l’avez noté, le pouvoir central, la Justice et le pouvoir local autour de la table. Notons au passage qu’aucun médecin n’est convoqué pour parler épidémie. Mais précisément il ne s’agit pas de parler d’épidémie (!) mais de traiter des moyens d’approvisionner la cité.
Ils sont tous quatre assemblés. Pas de masque mais « en se tenant à une certaine distance les uns des autres ». (Sic, page 642 – 2°§). Cela ne vous évoque rien ?
Le texte de notre cher Abbé et académicien Jean-Pierre Papon est riche d’informations. Que vont décider nos quatre compères ? De créer deux marchés : l’un sur le chemin d’Aix-en-Provence ; l’autre sur celui d’Aubagne.
« Les marseillais séparés des vendeurs par une double barrière pouvaient acheter les denrées dont ils avaient besoin sous l’inspection des Officiers et des gardes préposés pour maintenir la tranquillité ».
Cela, à nouveau, ne vous évoque t-il rien ? Le terme de « passe sanitaire » n’était pas encore inventé, mais … On ouvrit aussi un autre marché à l’Estaque pour les produits venant de la mer. Mais comme tout manquait, les prix flambèrent. Tout le monde se retrouvait massé sur les trois seuls marchés, serré comme aujourd’hui sur les quais d’un métro. Là, point de barrière. Les valides encore aptes à faire quelques modestes courses alimentaires s’en retournaient chez eux porteurs de maigres subsistances et … de l’infection.
« Le plus grand malheur des Marseillais, malheur qui en occasionna beaucoup d’autres, fut de n’avoir pas à la tête de l’Administration des personnes capables d’établir une police sévère et de la faire observer ». (Le terme police doit ici être entendu dans le sens de réglementation plus que dans celui de force policière.)
Les avis ne cessaient de diverger. Pour les uns, comme les médecins Peyssonnel, père et fils, la situation était grave. Pour les autres … Devant tant d’hésitations du Pouvoir et d’injonctions contradictoires, les marseillais qui le pouvaient fuyaient à la campagne ; les autres « s’empressaient de faire des provisions » (page 645 §2). Ceux qui n’avaient point de maison à la campagne campaient sous des tentes, le long de l’Huveaune et des ruisseaux et jusque dans des cavernes.
« Les gens de mer s’embarquaient avec leur famille sur des vaisseaux, sur des barques et des petits bateaux, se tenant au large dans le port ou dans la rade et présentant ainsi, au milieu des eaux, une ville flottante. »
Non fluctuat, Massilia, sed mergitur !
Le Pouvoir, désarmé, débordé, incapable n’eût qu’une ressource : la police. « Les échevins levèrent quatre compagnies de Milice. (Page 646 idem). Il est plus facile de lutter contre les désordres que contre l’épidémie. Cela donnait l’impression d’une action, d’une volonté, d’une décision.
« Chaque quartier eut un commissaire chargé de maintenir le bon ordre dans son district, de s’informer sur le nombre de malades qu’il y avait dans chaque maison, … »
Un régime policier restreignant les libertés publiques et privées s’abattit sur la ville. Il fut « interdit de transporter les meubles et les hardes des morts et des malades d’une maison à l’autre … »
Les magasins étaient fermés, « le commerce interdit, les travaux interrompus, tous les lieux publics fermés, les offices divins suspendus et le cours de la Justice arrêté … Les amis se fuyaient, le voisin craignant de recevoir son voisin … Un frère en santé n’avait pas la liberté de voir une sœur mourante … ». On mourait seul, sans le secours de ses parents, de sa femme ou de son époux, sans ses enfants, dans l’abandon …
Mais nous étions dans les années 1720-1721. Un autre siècle !
Il est vrai que l’Histoire ne se répète jamais. Et nous pouvons nous féliciter et nous réjouir de vivre d’autres temps dans notre France d’aujourd’hui.
Dans cette gestion catastrophique de l’épidémie, deux Institutions surent faire face …
(À suivre)
À Marseille, le 11 septembre 2021
Jean-Noël Beverini
***
PETITES CHRONIQUES DE LA GRANDE PESTE DE MARSEILLE (3)

Jean-Noël Beverini
Face à cette gestion catastrophique de l’épidémie, deux Institutions surent faire face. Vous avez deviné lesquelles :
- l’Église marseillaise,
- la marine au travers de son arsenal des Galères.
L’ÉGLISE DE MARSEILLE
Nous avons du mal à nous représenter aujourd’hui la situation de notre ville en ces années 1720-1721.
« Les nuits n’étaient pas assez longues pour avoir le tems de transporter les morts : il fallut mettre sous les yeux du public les pertes qu’il (le mal) faisait et qu’on avait eu grand soin de lui cacher ».
Trois siècles plus tard, pour cacher identiquement au bon peuple de France la situation et le défaut de stock de masques, le Pouvoir commença par l’assurer que les masques étaient inutiles avant de les rendre définitivement obligatoires !
« Les cadavres ne pouvant plus être emportés les uns après les autres, on fut obligés de les entasser dans des tombereaux … »
On les jetait par les fenêtres d’un premier étage. Ils s’amoncelaient des deux côtés des rues. Plus aucune maison n’était saine. Les hôpitaux étaient débordés car rien n’était prévu dans une ville-port commerçant depuis l’Antiquité avec un Orient infesté, de façon récurrente, par la peste et les épidémies.
« Nous avons remarqué que dans l’espace de dix sept siècles, qui se sont écoulés depuis Jules César, on en a ressenti plus de trente fois les funestes atteintes. » (Page 635).
Histoire, Histoire, quand on ne veut pas en retenir tes leçons !
« Le XV° siècle, poursuit notre académicien, a vu neuf fois la ville de Marseille plongée dans les horreurs de la peste. »
Comment ignorer que la « mondialisation » est aussi porteuse et pourvoyeuse de funestes effets ?
« À l’hôpital on voyait jusqu’à cinquante morts entassés dans les coins… Les places publiques étaient couvertes de morts et de mourants … Aussi voyait-on quelque fois de ces pestiférés se traîner pour aller tremper leur langue dans le ruisseau. »
« Le Cours (aujourd’hui cours Belzunce) était jonché de malades qui, croyant trouver un abri à l’ombre des arbres, y étaient exposés aux ardeurs d’un soleil brûlant. »
Il y avait des enfants de dix ans, d’autres au berceau ! D’autre « à la mamelle de leur mère ». Nous sommes, en effet, maintenant en plein été. « Tous ces corps hideux et difformes … »
Les échevins se réunirent et prirent une décision. Il était temps.
« Ils firent tendre quelques voiles de vaisseaux mais elles n’affaiblissaient que faiblement la chaleur du jour et ne garantissaient pas de la fraîcheur pendant la nuit. »
Plus de mille morts par jour et les échevins, dont notre cher Estelle, font tendre de vieilles voiles de bateaux pour seul remède. (Heureusement que notre Abbé-académicien de Marseille ne nous indique pas que ces anciennes voiles sont celles … du Grand Saint-Antoine !).
Ne doit-on pas parler, en l’occurrence, de véritable mépris ? Et tant de souffrances pour la cupidité de quelques financiers, négociants et élus ayant financé un voyage maritime qu’ils voulaient rémunérateurs ! Quelles qu’en soient les conséquences.
« Rue Dauphine … Les malades et les morts y étaient si pressés qu’on ne pouvait sortir de sa maison sans marcher dessus. »
Au bout de cette rue Dauphine (drôle de rue à la mauvaise mine !) se trouvait « l’hopital des convalescens ». Mais évidemment, plus aucun lit de libre. Les pestiférés, refusés, s’en retournaient mourir sur la chaussée.
Les chiens, sans maître, mangeaient les cadavres. Certains pestiférés étant encore vivants ! On les tua. Les chiens, pas les pestiférés!
« Les rues furent bientôt recouvertes de chiens morts (Page 657).
On les jeta dans le Port. L’odeur, ajoutée à celle des cadavres humains, devint épouvantable.
FACE À CET ENFER : L’ÉGLISE DE MARSEILLE
« Si l’on recevait quelques secours utiles, c’était de la main de monsieur l’Évêque ».
Et aussi :
« Les cures et les vicaires des différentes paroisses se dévouèrent aux fonctions pénibles de leur ministère avec un zèle digne des plus beaux siècles de l’Église. »
Nos prêtres portent les sacrements, consolent et meurent à leur tour. Les chanoines, au contraire, ont fui. Mais les curés et les prêtres des paroisses, les Ordres tels les Augustins réformés, les Grands-Carmes, les Trinitaires, les Carmes-Déchaussées « se privaient du nécessaire pour secourir les indigents, leur unique ambition étant de secourir les malheureux et de mourir eux-mêmes, s’il le fallait dans cet exercice de charité. »
XX
Les Trinitaires de Marseille! Nous possédons encore la Tour des Trinitaires que mon si cher ami René Pierini, (+) président de Marseille-Patrimoine et Mémoire, me commentait. Elle est dans un état scandaleusement pitoyable. Depuis tant d’années. Merci pour le remerciement !
Marseille n’a jamais eu de reconnaissance, ni pour son Histoire, ni pour son patrimoine. Hier comme aujourd’hui. Je suis profondément désolé de le redire.
Et cela ne surprendra personne. Notre ville est d’une rare ingratitude pour son passé souvent illustre. Nous détruisons, nous bradons, nous vendons. Nous vendons notre âme. Nous avons vendu notre âme aux financiers, aux immobiliers, aux marchands. Ce que nous n’avons pas réussi à vendre, nous le laissons périr et dépérir. Comment avoir abandonné notre carrière fondatrice !
Comment avoir enterré une seconde fois les vestiges uniques dits du Collège Vieux-Port. Malgré la demande exprimée personnellement par madame Jacqueline de Romilly, de l’Académie française, et monsieur Etienne Taillemite, Inspecteur général des Archives de France ? Comment avoir rayé de notre histoire l’histoire de la basilique de Malaval ? Comment avoir … Comment n’avoir pas su ? À force de détruire, de raser, d’oublier, c’est nous que nous oublions, c’est nous que nous rasons, c’est nous que nous détruisons.
Marseille se plait et se complait à s’afficher la première et plus ancienne ville de France. À juste titre. Mais elle est la dernière des villes de France et d’Europe à conserver et à valoriser ses vestiges et son Histoire. Marseille a choisi de mettre son Histoire dans une tombe. On ne fait pas d’une tombe une Histoire.
La personnalité de monseigneur de Belzunce resplendit au dessus de cette désolation qu’est cette peste de 1720-1721. L’Église de Marseille est présente. Heureusement. Des 29 jésuites sur place, 18 succombent. L’un d’eux, le Père Milet, crée une cuisine pour les pestiférés, sorte de Resto du Cœur avant l’heure. Toujours l’Église.
Belzunce bravait le danger, réconfortant, aidant, priant, bénissant les vivants, les morts et les mourants, courant les rues pieds-nus, au milieu des cadavres, en habit de pénitence, lui le grand prélat.. L’Église, seul recours « au péril de sa vie », expression avant l’heure.
Mais surtout l’Église marseillaise résistait au Pouvoir, devenant un « contre-pouvoir ». Non, une seule réponse par la création d’une milice policière ne suffisait pas. Non, interdire, interdire, interdire les déplacements, les déménagements, l’accès à différents lieux, ne suffisait pas. Il fallait être présent. Mouiller sa chemise. Belzunce a eu cet honneur de mouiller sa chasuble et son aube. Personne d’autres ne l’a fait, sauf celui dont nous parlerons ensuite.
Qui a fait du bien aux marseillais ?
Sur les 25 chirurgiens, en septembre 1720 il en reste quatre. Deux sont malades. Les deux autres s’enfuient. Les apothicaires qui n’étaient pas morts « profitant des circonstances, vendirent leurs drogues à un prix extraordinaire et trouvèrent une source de richesses dans les malheurs publics »
On n’appelait pas encore les Apothicaires, Laboratoires ou Groupes pharmaceutiques, les apothicaires du moment.
« Dans cette affreuse désolation, les Échevins sentirent que l’administration de cette grande ville était au dessus de leur force « (page 664)
Que firent-ils ?
À suivre.
***
PETITES CHRONIQUES DE LA GRANDE PESTE DE MARSEILLE (4 et fin)

Jean-Noël Beverini
« Dans cette affreuse désolation, les Échevins sentirent que l’administration de cette grande ville était au dessus de leur force ».
Que firent-ils ?
Dépassés par les événements, les Échevins, du moins ceux qui n’avaient pas fui, allèrent frapper à la porte de l’Arsenal des galères. La discipline régnant dans l’arsenal les impressionnait et les édiles regrettèrent de n’avoir pas fait appel plus précocement à l’autorité militaire maritime.
Aussitôt de nouvelles mesures furent prises par l’Intendant des Galères :
- les rues furent nettoyées,
- les cadavres enlevés,
- l’obligation fut faite aux parents de porter eux-mêmes leurs morts dans les rues « afin que les corbeaux ne fussent point forcés d’entrer dans les maisons où ils enlevaient tout ce qu’ils trouvaient de précieux ».
Mais les galériens employés à ces tâches ne savaient ni conduire les tombereaux qui se renversaient, ni mener les chevaux. Cerise sur le gâteau, ou plutôt sur le bubon, les tombereaux ne pouvaient passer dans l’étroitesse des rues souvent en pente. (Le Bataillon de marins-pompiers a dû inventer des matériels sur roues pour accéder dans ces anciennes rues.) « On avait à peine vidé une rue, une place que le lendemain elles étaient encore couvertes de cadavres ».
On imagina « prendre le plus gros vaisseau du Port, de le démâter et de le vider entièrement pour le remplir de morts, de le fermer ensuite et de l’aller couler à fond loin de la ville ». Mais les corps gonflés par l’eau seraient venus s’échouer sur le rivage. On abandonna l’idée.
On manquait de tout. On manquait de chaux pour recouvrir les cadavres, comme on a manqué de masques au début de la pandémie. Il n’y avait plus de lits disponibles dans les hôpitaux, comme dans nos services d’urgence. « La maladie enlevait tout ». (Page 667). Les chevaux eux-mêmes mouraient de lassitude.
Le 6 septembre, il y avait plus de 2000 morts dans les rues ! Des cadavres qui pourrissaient. L’arsenal fut à nouveau sollicité : 100 galériens de plus, 40 soldats, 4 caporaux et 4 officiers « de sifflet ». Ces officiers transmettaient leurs ordres par ce moyen sonore.
Les Échevins ne regardaient plus à la dépense. C’était déjà le « Quoi qu’il en coûte » ! Nous n’avons rien inventé ! Même à 15 francs par jour, mis à part les galériens, on ne trouvait personne.
1400 orphelins étaient sans asile. Bientôt davantage. Un homme redoublait d’activité : le chevalier Roze. Au contact de l’arsenal des galères, il divisa les forçats en quatre brigades, déployant un courage au dessus de ses forces. Choisissant deux bastions creux des remparts en bord de mer, il fit apporter de la chaux, obligea les galériens à s’entourer la tête d’un mouchoir imbibé de vinaigre. En moins d’un jour, 2000 cadavres déjà rongés par les vers furent ensevelis.
Que fait Versailles ?
« Le Roi (le Régent) instruit de la déplorable situation de Marseille, donna, le 12 septembre, le commandement de la ville et du terroir à monsieur de Langeron, chef d’escadre des galères ».
Pour remplacer la déficience du pouvoir civil, on fit appel au Corps des galères, à la marine et à ses officiers. Cela ne vous fait-il pas penser à l’origine de la création du Bataillon de Marins-pompiers ?
400 nouveaux forçats sont aux ordres. En trois jours on multiplie les lits d’hôpitaux. Monsieur de Langeron ordonne aux apothicaires de revenir, comme aux notaires, aux sages-femmes et aux officiers municipaux déserteurs.
Au côté du chef spirituel qu’est monseigneur de Belsunce (que l’Abbé Papon écrit Belzunce), voilà enfin un chef du pouvoir civil en la personne du chef d’escadre des Galères, ce monsieur de Langeron, totalement oublié. Pourquoi occulte t-on que le salut de la ville revînt à la marine, par le bras de son arsenal des galères avec l’aide et le dévouement du Chevalier Roze ? Dans le désarroi général, la seule autorité, la seule survie, la seule espérance ont tenu à l’action du Corps royal des Galères, à son chef et à ses officiers.
Les décisions se multiplient :
- un hôpital entier est dédié aux malades de la peste, l’hôpital des Équipages,
- l’hôpital des Forçats est réservé pour les maladies ordinaires,
- un hôpital d’entrepôt est créé à la Corderie ; on y portait un homme sur la plus légère indisposition,
- « des chaloupes portaient dans ces hôpitaux les vivres et les remèdes dont ont avait besoin » (Page 667).
Que voilà une organisation rationnelle des soins ! On dédia des galères pour les convalescents. « Par ces sages dispositions, les nouveaux malades trouvaient toujours des places vacantes à l’hôpital ».
Si la situation s’améliorait en ville, celle des campagnes s’aggravait. Le terroir se remplissait à son tour de morts et de mourants. Notre cher Abbé donne deux exemples émouvants d’humanité et d’amour :
« Un paysan et sa femme furent attaqués en même temps de la peste et se regardèrent comme perdus. Le mari creusa deux fosses avant que la maladie eût épuisé ses forces. Ensuite quand il sentit approcher sa dernière heure, il fit ses adieux à sa femme et se traînant jusqu’à la fosse, il s’y laissa tomber et s’enterra pour ainsi dire tout vivant » évitant ainsi tout contact de sa femme avec son corps !
« Une autre paysanne refusait d’être soignée par son mari pour le protéger. Elle lui demanda une longue corde qu’elle s’attacha aux pieds afin qu’il puisse la traîner dans la fosse sans la toucher » ? (Page 681)
Enfin la contagion perdit de sa force « parce que les chaleurs diminuaient … La nature travaillait seule à la guérison des malades » (Page 684). Nous étions au mois d’octobre. Monsieur de Langeron faisait contrôler les accès à la ville, les frontières n’étant pas ouvertes. La marine et les galériens continuaient à « enlever les morts dans l’instant même. Les médecins n’étaient toujours pas d’accord entre eux ! (Page 692)
Le calme revenait et on goûtait à nouveau « le plaisir de se voir et de s’embrasser ».
C’est ce que je vous souhaite.
FIN
À Marseille, le 28 septembre 2021
Jean-Noël Beverini
- Vues: 1228